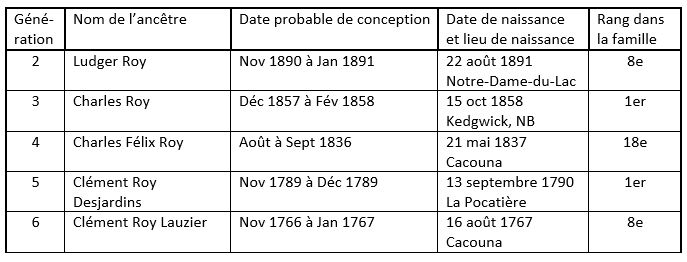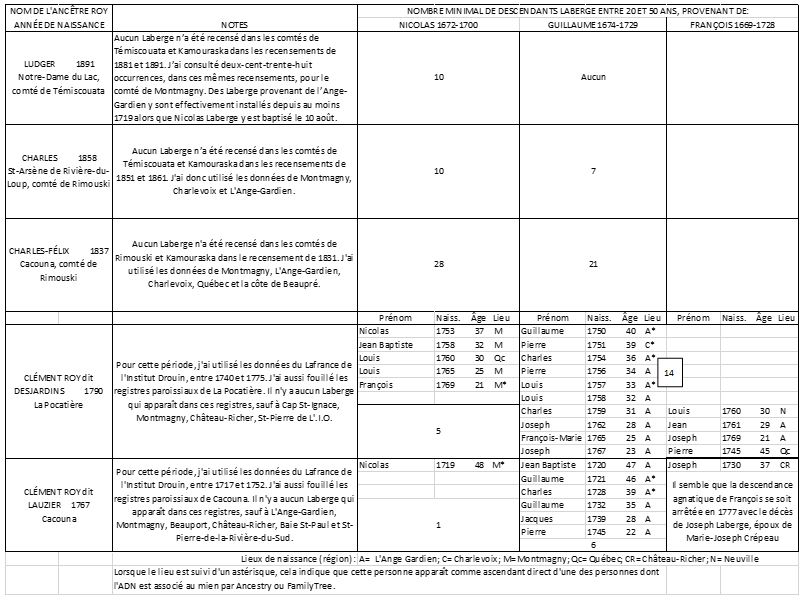Il est grand temps que l’INSPQ admette la transmission par aérosols de la Covid-19 et agisse en conséquence en protégeant mieux les travailleuses de la santé, de l’éducation et des services de garde!
The Lancet, 15 avril 2021 : Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2
Par: Trisha Greenhalgh, Jose L Jimenez, Kimberly A Prather, Zeynep Tufekci, David Fisman et Robert Schooley
[Traduction libre…] Document original : Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2 – The Lancet
L’examen systématique de Heneghan et de ses collègues, financé par l’OMS, publié en mars 2021 et en pré impression, indique : « L’absence d’échantillons récupérables de culture virale du SRAS-CoV-2 empêche de tirer des conclusions fermes sur la transmission aéroportée ».1 Cette conclusion, ainsi que la large diffusion des conclusions de l’examen, sont préoccupantes en raison des répercussions sur la santé publique.
Si un virus infectieux se propage principalement par de grandes gouttelettes respiratoires qui tombent rapidement, les principales mesures de lutte sont la réduction du contact direct, le nettoyage des surfaces, les barrières physiques, la distanciation physique, l’utilisation de masques à distance de gouttelettes, l’hygiène respiratoire et le port d’une protection de haute qualité uniquement pour les procédures de soins de santé dites génératrices d’aérosols. De telles politiques n’ont pas besoin de faire la distinction entre l’intérieur et l’extérieur, puisqu’un mécanisme de transmission par gravité serait semblable pour les deux paramètres. Mais si un virus infectieux est principalement en suspension dans l’air, une personne pourrait être infectée lorsqu’elle inhale des aérosols produits lorsqu’une personne infectée expire, parle, crie, chante, éternue ou tousse. Pour réduire la transmission aérienne du virus, il faut prendre des mesures pour éviter l’inhalation d’aérosols infectieux, y compris la ventilation, la filtration de l’air, la réduction de l’encombrement et du temps passé à l’intérieur, l’utilisation de masques à l’intérieur, l’attention portée à la qualité et à l’ajustement des masques et une protection de qualité supérieure pour le personnel de santé et les travailleurs de première ligne.2 La transmission aérienne de virus respiratoires est difficile à démontrer directement.3
Les résultats mitigés d’études qui visent à détecter un agent pathogène viable dans l’air ne sont donc pas des motifs suffisants pour conclure qu’un agent pathogène n’est pas en suspension dans l’air si l’ensemble des preuves scientifiques indiquent le contraire. Des décennies de recherches minutieuses, qui n’incluaient pas la capture d’agents pathogènes vivants dans l’air, ont montré que les maladies autrefois considérées comme propagées par les gouttelettes sont en suspension dans l’air.4 Dix sources de données appuient collectivement l’hypothèse selon laquelle le SRAS-CoV-2 est transmis principalement par la route aérienne.5
Premièrement, les événements de contagion élevée s’expliquent par une transmission importante du SRAS-CoV-2; en effet, de tels événements peuvent être les principaux moteurs de la pandémie.6 Des analyses détaillées des comportements et des interactions humaines, de la taille des pièces, de la ventilation et d’autres variables dans les concerts de chorales, les navires de croisière, les abattoirs, les foyers de soins et les établissements correctionnels, entre autres, ont montré des modèles, par exemple, la transmission à longue portée et la dispersion élevée du nombre de reproduction de base (R 0), discuté ci-dessous , compatible avec la propagation aérienne du SRAS-CoV-2 qui ne peut pas être adéquatement expliquée par des gouttelettes ou des vecteurs passifs.6 L’incidence élevée de tels événements suggère fortement la dominance de la transmission d’aérosols.
Deuxièmement, la transmission à longue portée du SRAS-CoV-2, entre les personnes vivant dans des chambres adjacentes, mais jamais en présence de l’autre, n’a été documentée dans les hôtels de quarantaine.7 Historiquement, il n’était possible de prouver la transmission à longue portée qu’en l’absence totale de transmission communautaire.4
Troisièmement, la transmission asymptomatique ou pré symptomatique du SRAS-CoV-2, par des personnes qui ne toussent pas ou n’éternuent pas, est susceptible de représenter au moins un tiers, et peut-être jusqu’à 59 %, de toute transmission à l’échelle mondiale et est un moyen clé de propagation du SRAS-CoV-2 dans le monde entier,8 d’un mode de transmission principalement aéroporté. Les mesures directes montrent que parler produit des milliers de particules d’aérosol et peu de grosses gouttelettes,9 qui prennent la voie aérienne.
Quatrièmement, la transmission du SRAS-CoV-2 est plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur10 et est considérablement réduite par la ventilation intérieure.5 Les deux observations soutiennent une voie de transmission principalement aéroportée.
Cinquièmement, les infections nosocomiales ont été documentées dans les organisations de soins de santé, où il y a eu des précautions strictes en matière de contact et de gouttelette et l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI) conçu pour se protéger contre l’exposition aux gouttelettes, mais pas aux aérosols.11
Sixièmement, un SRAS-CoV-2 viable a été détecté dans l’air. Dans le cadre d’expériences en laboratoire, le SRAS-CoV-2 est resté infectieux dans l’air jusqu’à 3 h avec une demi-vie de 1·1 h.12 Le SRAS-CoV-2, toujours viable, a été identifié dans des échantillons d’air provenant de pièces occupées par des patients covid-19 en l’absence de procédures de soins de santé génératrices d’aérosols13 et dans des échantillons d’air de la voiture d’une personne infectée.14 Bien que d’autres études n’aient pas permis de saisir le SRAS-CoV-2 viable dans les échantillons d’air, il faut s’y attendre. L’échantillonnage du virus en suspension dans l’air est techniquement difficile pour plusieurs raisons, y compris l’efficacité limitée de certaines méthodes d’échantillonnage pour la collecte des particules fines, la déshydratation virale pendant la collecte, les dommages viraux dus aux forces d’impact (entraînant une perte de viabilité), la ré-aérosolisation du virus pendant la collecte et la rétention virale dans l’équipement d’échantillonnage.3 La rougeole et la tuberculose, deux maladies principalement aéroportées, n’ont jamais été cultivées dans l’air d’une pièce.15
Septièmement, le SRAS-CoV-2 a été identifié dans les filtres à air et les conduits d’aération dans les hôpitaux avec des patients atteints de COVID-19; ces emplacements ne pouvaient être atteints que par des aérosols.16
Huitièmement, des études portant sur des animaux en cage, infectés, qui étaient reliés à des animaux non infectés en cage séparée par l’intermédiaire d’un conduit d’air ont montré une transmission du SRAS-CoV-2 qui ne peut être expliquée adéquatement que par des aérosols.17
Neuvièmement, aucune étude, à notre connaissance, n’a fourni de preuves solides ou cohérentes pour réfuter l’hypothèse d’une transmission aéroportée du SRAS-CoV-2. Certaines personnes ont évité l’infection par le SRAS-CoV-2 lorsqu’elles ont partagé de l’air avec des personnes infectées, mais cette situation pourrait s’expliquer par une combinaison de facteurs, y compris la variation de la quantité d’excrétion virale entre les personnes infectieuses par plusieurs ordres de grandeur et différentes conditions environnementales (en particulier de ventilation).18 Les variations individuelles et environnementales signifient qu’une minorité de cas primaires (notamment les individus qui excédent des niveaux élevés de virus à l’intérieur, des environnements surpeuplés avec une mauvaise ventilation) représentent la majorité des infections secondaires, ce qui est étayé par des données de recherche de contacts de haute qualité provenant de plusieurs pays19, 20.Une grande variation de la charge virale respiratoire du SRAS-CoV-2 balaie les arguments selon lesquels le SRAS-CoV-2 ne peut pas être en suspension dans l’air parce que le virus a un R plus faible (estimé à environ 2·5)21, rougeole (estimée à environ 15),22 d’autant plus que R 0, qui est une moyenne, ne tient pas compte du fait que seule une minorité d’individus infectieux perdent de grandes quantités de virus. La dispersion élevée de R 0 est bien documenté dans la COVID-19.23
Dixièmement, il y a peu de preuves à l’appui d’autres voies dominantes de transmission, c’est-à-dire la gouttelette respiratoire ou le vecteur passif (fomite) 9 , 24 . La facilité d’infection entre les personnes proches les unes des autres a été citée comme preuve de la transmission respiratoire des gouttelettes du SRAS-CoV-2. Cependant, la transmission à proximité dans la plupart des cas ainsi que l’infection lointaine pour quelques-uns lors du partage de l’air est plus susceptible de s’expliquer par la dilution des aérosols expirés avec la distance d’une personne infectée.9 L’hypothèse erronée selon laquelle la transmission par proximité implique de grandes gouttelettes respiratoires ou vecteurs passifs (fomites) a toujours été utilisée pendant des décennies pour nier la transmission aérienne de la tuberculose et de la rougeole15 , 25 . Cela est devenu un dogme médical, ignorant les mesures directes des aérosols et des gouttelettes qui révèlent des défauts tels que le nombre écrasant d’aérosols produits dans les activités respiratoires et la limite arbitraire de la taille des particules de 5 μm entre les aérosols et les gouttelettes, au lieu de la limite correcte de 100 μm15, 25 . On soutient parfois que puisque les gouttelettes respiratoires sont plus grosses que les aérosols, elles doivent contenir plus de virus. Toutefois, dans les maladies où les concentrations d’agents pathogènes ont été quantifiées par la taille des particules, les aérosols plus petits présentaient des concentrations pathogènes plus élevées que les gouttelettes lorsque les deux ont été mesurées.15
En conclusion, nous proposons qu’il s’agit d’une erreur scientifique d’utiliser l’absence de preuves directes du SRAS-CoV-2 dans certains échantillons d’air pour jeter le doute sur la transmission aérienne tout en négligeant la qualité et la solidité de la base globale de données probantes. Il existe des preuves solides et cohérentes que le SRAS-CoV-2 se propage par transmission aérienne. Bien que d’autres itinéraires puissent y contribuer, nous croyons que la route aérienne est susceptible d’être dominante. Le milieu de la santé publique devrait agir en conséquence et sans plus tarder.
References:
TG’s research is funded by the National Institute for Health Research ( BRC-1215-20008 ), Economic and Social Research Council ( ES/V010069/1 ), and Wellcome ( WT104830MA ). JLJ is supported by the US National Science Foundation ( AGS-1822664 ). KAP is supported by the US National Science Foundation Center for Aerosol Impacts on the Chemistry of the Environment (CHE-1801971). DF is funded by the Canadian Institutes for Health Research (2019 COVID-19 rapid researching funding OV4-170360). RS is supported by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (AI131424). We declare no other competing interests.
References
- Heneghan C, Spencer E, Brassey J, et al.
SARS-CoV-2 and the role of airborne transmission: a systematic review.
F1000Research. 2021; (published online March 24.) (preprint).
https://doi.org/10.12688/f1000research.52091.1
2. Prather KA, Wang CC, Schooley RT
Reducing transmission of SARS-CoV-2.
Science. 2020; 6498: 1422-1424
- Pan M, Lednicky JA, Wu CY
Collection, particle sizing and detection of airborne viruses.
J Appl Microbiol. 2019; 127: 1596-1611
4. Gelfand HM, Posch J
The recent outbreak of smallpox in Meschede, west Germany.
Am J Epidemiol. 1971; 93: 234-237
5. Morawska L, Milton DK
It is time to address airborne transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Clinical Infect Dis. 2020; 71: 2311-2313
6. Lewis D
Superspreading drives the COVID pandemic—and could help to tame it.
- Eichler N, Thornley C, Swadi T, et al.
Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 during border quarantine and air travel, New Zealand (Aotearoa).
Emerging Infect Dis. 2021; (published online March 18.)
- Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al.
SARS-CoV-2 transmission from people without COVID-19 symptoms.
- Chen W, Zhang N, Wei J, Yen H-L, Li Y
Short-range airborne route dominates exposure of respiratory infection during close contact.
- Bulfone TC, Malekinejad M, Rutherford GW, Razani N
Outdoor transmission of SARS-CoV-2 and other respiratory viruses: a systematic review.
- Klompas M, Baker MA, Rhee C, et al.
A SARS-CoV-2 cluster in an acute care hospital.
Ann Intern Med. 2021; (published online Feb 9.)
- Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al.
Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1.
New Engl J Med. 2020; 382: 1564-1567
- Lednicky JA, Lauzard M, Fan ZH, et al.
Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients.
Int J Infect Dis. 2020; 100: 476-482
- Lednicky JA, Lauzardo M, Alam MM, et al.
Isolation of SARS-CoV-2 from the air in a car driven by a COVID patient with mild illness.
medRxiv. 2021; (published online Jan 15.) (preprint).
https://doi.org/10.1101/2021.01.12.21249603
- Fennelly KP
Particle sizes of infectious aerosols: implications for infection control.
Lancet Respir Med. 2020; 8: 914-924
- Nissen K, Krambrich J, Akaberi D, et al.
Long-distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards.
Sci Rep. 2020; 10: 1-9
- Kutter JS, de Meulder D, Bestebroer TM, et al.
SARS-CoV and SARS-CoV-2 are transmitted through the air between ferrets over more than one meter distance.
Nat Commun. 2021; 12: 1-8
- Schijven J, Vermeulen LC, Swart A, Meijer A, Duizer E, de Roda Husman AM
Quantitative microbial risk assessment for airborne transmission of SARS-CoV-2 via breathing, speaking, singing, coughing, and sneezing.
Environ Health Perspect. 2021; 12947002
- Sun K, Wang W, Gao L, et al.
Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2.
Science. 2021; 371eabe2424
- Laxminarayan R, Wahl B, Dudala SR, et al.
Epidemiology and transmission dynamics of COVID-19 in two Indian states.
Science. 2020; 370: 691-697
- Petersen E, Koopmans M, Go U, et al.
Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and influenza pandemics.
Lancet Infect Dis. 2020; 20: e238-e244
- Guerra FM, Bolotin S, Lim G, et al.
The basic reproduction number (R0) of measles: a systematic review.
Lancet Infect Dis. 2017; 17: e420-e428
- Endo A, Abbott S, Kucharski AJ, Funk S
Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China.
Wellcome Open Res. 2020; 5: 67
- Goldman E
Exaggerated risk of transmission of COVID-19 by fomites.
Lancet Infect Dis. 2020; 20: 892-893
- Tang JW, Bahnfleth WP, Bluyssen PM, et al.
Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2).
J Hosp Infect. 2021; 110: 89-96
Article Info: The Lancet, April 15, 2021
Identification: DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00869-2
Copyright © 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.